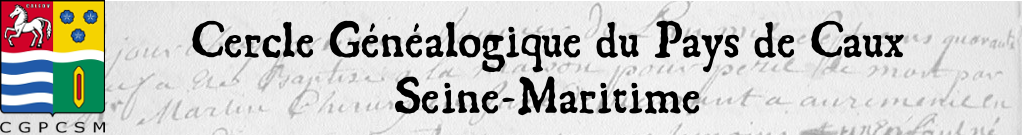Les enfants martyrs des verreries
par
popularité : 3%

L’industrie du verre dans la vallée de la Bresle est très ancienne puisqu’elle remonte au moyen âge ; période à laquelle les verreries étaient implantées en forêt d’Eu. Elles fabriquaient de la verroterie et du verre plat, notamment des vitres et des vitraux pour les belles demeures et les églises.
C’est Colbert qui encourage la fabrication du verre. Les forêts jouèrent un grand rôle pour le bois des fours. Les verriers se servaient de ses éléments pour pratiquer leur métier. Le bois alimentait donc les fours et les cendres des fougères fournissaient la potasse nécessaire à la fusion du sable pour créer le verre.
Jusqu’à la révolution, pour établir une verrerie, il fallait impérativement un privilège, autorisation royale donnée par lettre patente. Les verriers eurent rang de gentilshommes et portèrent l’épée. Je vais m’intéresser plus particulièrement à la verrerie de Romesnil.
Création de la verrerie de Romesnil :
En 1773, les époux Libaude associés avec de Bongars de Roquigny, une des quatre grandes familles de verriers, dans la verrerie du val d’aulnoy, avaient remporté le prix proposé par l’académie des sciences. Ce prix est doté par le roi Louis XVI, en faveur de celui qui ferait connaître en France, le meilleur procédé de fabriquer un verre pesant, exempt de défauts, ayant toutes les qualités du flint glass anglais, à l’usage des lunettes achromatiques.
En 1776, le 28 juillet, le sieur Jean Baptiste Libaude obtient du Duc de Penthièvre, comte d’Eu, le privilège de créer une verrerie au hameau de Romesnil, au village de Nesles-Normandeuse, dans la haute forêt d’Eu, où sera fabriqué d’abord du verre à vitre, à l’imitation de ceux de Bohême, vulgairement nommés verre à manchon, puis ensuite produit du cristal après le XVIII ème siècle (vers 1804).
En 1777, le 6 mars, il achète le Château de Romesnil à Louis-Jean-Marie de Bourbon, Duc de Penthiève (petit-fils en ligne bâtarde de Louis XIV de France) qui s’en servait de rendez-vous de chasse. Ce château deviendra la résidence des maîtres verriers.
Les lettres de concession précisaient que l’emplacement de cette usine serait à une lieue de toute autre verrerie. Elle fut construite près du château de Romesnil. L’usine fut mise en activité au mois de mars 1778. On commença, à cette époque, à y faire du verre à vitres en manchons, façon de Bohême et d’Alsace. Les époux Libaude avaient fait venir, à grands frais, de la Bohême, des ouvriers sachant fabriquer cette espèce de verre. Je pense Plutôt que c’était des descendants de ses verriers de Bohême qui étaient venus en Moselle, en 1737, pour développer une nouvelle manufacture et lancer une production de cristal.
Voir l’histoire entière sur mon article « Les Gruels, histoire d’une famille » :
https://www.geneacaux.fr/spip/spip.php?article301
Une main d’Oeuvre sélectionnée :
Je retrouve la trace du premier directeur de la verrerie de Romesnil en mai 1778. Il se nomme Jean Dominique Eppechtern (Ou Epechetenner). Celui-ci nait le 18 mars 1752, à la verrerie, au lieu-dit de Lettenbach, à Saint Quirin, en Moselle, lieu où son père est maître verrier. Cette verrerie est l’une des plus anciennes de Lorraine, puisque les historiens attestent sa prèsence dès le XV ème siècle. Elle travaillait pour les châteaux et forteresses de Lorraine. C’était une verrerie itinérante qui changeait d’emplacement une fois que la ressource en bois étaient épuisée.
Jean Dominique est le fils de Joannès et de Anne Marie Stein, originaire d’Allemagne. A l’âge de dix huit ans, en 1770, Jean Dominique est verrier, à Rouelles, dans la région du Barrois, en Haute Marne. Cette manufacture créée en 1759, connut quelques années heureuses entre 1770 et 1778, date d’arrêt de la fabrication. Ce fut certainement une opportunité pour Jean Dominique, pour venir travailler à Romesnil. Il fut certainement nommé à ce poste de directeur par Jean Baptiste Charles Libaude, époux de Marie Catherine Louise Dubuisson, chimiste et maître verrier.
Un oncle et une Soeur Catherine Eppechtern et sa famille le rejoignirent à Romesnil avant 1786, date de naissance de la fille de cette dernière, en ce lieu . Celle-ci s’était mariée le 27 janvier 1777, à Rouelle, en Haute Marne, avec Jean Sery, ouvrier verrier à la manufacture de glaces, de Rouelle.
Plus tard, en janvier 1788, c’est Antoine Marcel Nicolas Lefenne qui est directeur de la verrerie.
Parmi les nombreux ouvriers verriers venus de Moselle, on trouve :
Sébastien Sigwart, né en Allemagne, en 1761, maître souffleur en verre, ouvrier en verre à vitres, à Romesnil, de 1782 à 1794.
Adam Paltz, époux de Barbe Lesnart, étendeur de verre, en 1778.
Sébastien Sigouard et sa famille, originaire d’Allemagne, ouvrier en verre à vitres, en 1783.
Baltasar Salzman, époux de Marie Anne Lotte, souffleur de verre à mancheron, en 1808. Leur mariage eut lieu à Pierrecourt, le 30 janvier 1788. A ce mariage, les témoins sont : Jean Baptiste Gruel d’Inderville, officier d’infanterie, Nicolas Mayer et Jean Baptiste Seller, verriers.
Louis Eppechtern (Ou Epechetenner), maître fondeur, fils de Guillaume, maître souffleur et de Marie Barbe Foller. (juillet 1783)
Melchior Schmid, Jean Sellaire et autres……………….
Pour compléter cette main d’oeuvre spécialisée venue de Moselle, on trouvait des ouvriers locaux tel que Jean Baptiste Blanchon, porteur de sable et une majorité de jeunes enfants.
L’abus de la main d’oeuvre enfantine :
L’abus de la main d’oeuvre enfantine existe depuis toujours ; mais il a grandi avec le développement de la verrerie. En cette fin du XVIII ème siècle sous l’ancien régime, les familles habitant les campagnes sont nombreuses et ont beaucoup d’enfants. Ceux-ci aident principalement aux travaux des champs. Au XIX ème siècle, les patrons confessent sans honte que leur industrie tient à cela. En Normandie où la verrerie s’est fortement développer et constitue l’industrie dominante dans la vallée de la Bresle et où les maîtres verriers sont de véritables seigneurs, cette exploitation des enfants est sans frein. On les recrutait dans les milieux les plus pauvres, dans les campagnes environnantes où les familles sont nombreuses.
Ils commencèrent à prendre des enfants âgés seulement de sept ans , les « gamins » ; puis plus tard de neuf ou dix ans. L’élément primordial, c’est qu’ils puissent tenir un outil et courir. Les infractions à la loi sont tolérées. Les patrons rusent, fraudent et se moquent des inspecteurs avec la complicité inconsciente des ouvriers, qui, à chacune de leurs visites, vont cacher les enfants. Pris au fait ils s’en tirent avec des amendes de cent sous, somme modique. A ce prix là, ils ne se privent pas de récidiver.
Concernant le travail, un enfant de cet âge est un être sans défense. On le surcharge de travail, en lui imposant les mauvaises places à la chaleur ou dans la fumée. Il sert de bouche-trou à tous les postes. On l’insulte, on le frappe et on le surmène. Il plie sous la fatigue, il gémit, il pleure sans que personne le voit ni ne l’entend. Autour des fours , tous les employés souffrent et on est sans pitié. Pour les adultes quand un gamin tombe, se blesse ou se brûle, ce n’est rien, c’est le métier qui entre. Qui n’a pas entendu cela !
Cette exploitation va s’aggraver. L’appétit des patrons est sans bornes. Les maîtres verriers sont riches et influents. Ils ne se contentent plus d’en faire des auxiliaires. Ceux-ci font aussi des travaux d’hommes au feu des ouvreaux. Les ouvreaux sont les ouvertures faites aux parois des fours, par lesquelles les ouvriers prennent le verre à l’aide de la canne, qu’ils trempent dans les pots ou creusets. Ils y réchauffent aussi les pièces pour les finir. C’est devant les ouvreaux que les enfants ou adultes travaillent.
Le verrier, une fois qu’il a « cueillé » le verre dans son pot, vient le déposer dans un moule qui est ouvert et fermé par les enfants. Ces moules sont en bois. Les enfants doivent ensuite les plonger dans l’eau pour les refroidir. Les brûlures sont courantes.
Passés l’âge de treize ans, ils deviennent cueilleurs et sont encadrés par les adultes. Ils sont constamment aux ouvreaux, le corps près du feu. On exige d’eux la même résistance que les hommes. Ils sont maigres et souvent brûlés au visage ; ce qui leur donnent un aspect effrayant.
Entre quinze et seize ans, ils apprennent à souffler le verre. Ils passent souffleurs à l’âge de vingt ans. C’est un honneur d’être souffleur car la paye est plus forte. Malheureusement, à l’âge de trente ans, beaucoup ont des problèmes aux poumons.
Ces enfants comme les ouvriers travaillaient dans des conditions dangereuses et épuisantes. Ils étaient en contact direct avec la chaleur et les produits toxiques et dangereux tels que le plomb, la soude, la potasse, les colorats issus des métaux lourds.
C’est seulement en 1840, que les premiers débats sur le travail des enfants s’amorcent, autour d’un projet de loi présenté par le baron Dupin.
La bâtarderie de Romesnil :
Les gamins ou bâtards (enfants de l’assistance public) provenant des orphelinats de Dieppe, Rouen ou Paris sont logés dans des bâtarderies. Vers 1900, 50 % de la main d’oeuvre de la verrerie est enfantine. Les enfants travaillent 10 à 12h par jour dès l’âge de huit ans, pendant six jours par semaine. Malgré la loi de Jules Ferry, du 16 juin 1881, les verreries de la Bresle ne se départissent de cette main d’oeuvre qu’au cours des années 1920. Les gamins sont alors remplacés par un « gamin mécanique » ; machine qui reproduit chaque geste qu’effectue l’enfant.
Une autre loi du 2 novembre 1892, permet d’encadrer le travail des enfants. Ceux-ci devaient avoir treize ans révolus. Les enfants devaient être enregistrer sur un registre d’inscription délivré par le maire de la commune. Ce registre servait lors des contrôles de l’inspection du travail.
Logiquement dans la bâtarderie existe une salle de classe, un réfectoire, deux dortoirs et la chambre du surveillant. Le tenancier a vingt sous par jour pour nourrir et entretenir un apprenti verrier. Aussi, avec si peu d’argent, l’ordinaire est maigre. Le matin, à 8h, c’est une soupe et une ration de pain supplémentaire pour ceux qui ont dix huit ans. Ensuite c’est le repas à midi et le souper à 17h. Au cours de la journée, ils n’ont que de l’eau à boire. Les gamins sont si maigres et si frêles qu’ils rappellent ceux des pénitenciers.
Drame accidentel à la verrerie :
Le jeudi 2 octobre 1783, à Pierrecourt, a eu lieu l’inhumation de Jean Dubos, fils de jean, lattier, et de Marie Catherine Bertin, avec la permission de Mr Goddefroy, procureur du Roi. Son cadavre fut retrouvé noyé dans la citerne de la verrerie royale de Romesnil, la nuit du trente septembre. Le décès fut constaté par Mr Leborgne, chirurgien, à Neufchâtel. Jean Dubos n’était âgé que de seize ans.
La cloche :
Lors de ma visite au musée de la verrerie de Blangy sur Bresle, on trouve en exposition, à l’extérieur, sur un bâtiment, une cloche. Celle-ci provient de la verrerie de Romesnil. Elle y fut installée dès le XVIII ème siècle et servait à appeler les ouvriers lorsque la matière en fusion das les fours étaient à température pour la travailler.
F.Renout
(Administrateur cgpcsm)
Sources :
Recherches des familles sur les archives de Seine Maritime (Pierrecourt-Nesle Normandeuse)
Charles Delzant (le travail de l’enfance dans les verreries)
Ble Lorraine (Sur la route du verre et du cristal de Lorraine)
Georges Charles (l’art du cristal)
Le libertaire (exploitation des enfants au travail)