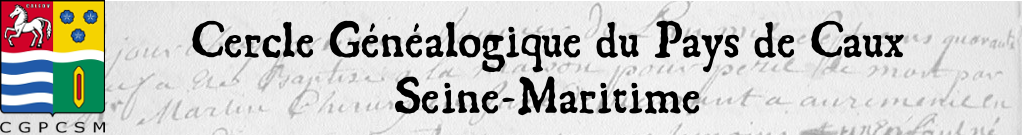Métier disparu : Le tireur ou tixier d’estaim
par
popularité : 1%

Il y a quelques temps, en lisant un acte dans les registres paroissiaux, dont je ne me souviens plus du nom du lieu, j’ai noté sur un bloc note ce métier : « tireur d’étaim », mentionné par le prêtre ou le clerc. Sur le moment, ce métier que je connaissais pas, m’a interpellé !
Le temps de ces derniers jours étant peu propice à une randonnée ou au jardinage, je me décidais à rechercher ce que pouvait être ce métier. Il existait autrefois dans les campagnes, des métiers qui ont disparu aujourd’hui ou qui se sont transformés. Ils correspondaient évidemment aux besoins de l’époque.
Au premier abord, quand on entend prononcer « étaim », on pense plus facilement au métal gris argenté très léger qui sert soit à la fabrication d’objets et de pièces de vaisselle, soit à réparer des ustensiles métalliques. L’ouvrier s’appelait un étameur ou rétameur. Ce métier ambulant est aujourd’hui disparu. Mais est-ce vraiment cela ?
Sur le moteur de recherche « Google », dès que l’on écrit « tireur d’étaim » , on vous propose « tireur d’étain ». Comme quoi « google » ne connaît pas ce mot !Vous voyez la nuance ?Si ces deux mots se prononcent pareil, si le son est le même, la définition est tout autre chose. C’est le « M » ou le « N » de la fin du mot qui fait la différence. Je serais donc partie sur une tout autre piste !Ce mot est aussi orthographié « Estaim ».
Dans les dictionnaires du XXI ème siècle, les mots « étaim et étaminier » n’existent plus. Pourtant ils qualifient une activité qui a donné du travail à des milliers de personnes surtout aux XVII et XVIII ème siècles ; époque d’expansion pour la fabrication d’une étoffe de laine appelée étamine. Plongeons nous maintenant dans le passé, à la recherche de ce métier oublié, en ayant une pensée pour nos ancêtres !
Sur le dictionnaire Diderot et d’Alembert édité entre 1751 et 1772, on trouve une définition concernant l’estame.
Le métier de tireur d’étaim :
Le serger ou sergetier est le nom du tireur d’étaim travaillant la laine. Le tissier travaille le lin, le chanvre puis le coton.
L’estaim est une longue laine peignée en grande carde, c’est à dire avec un peigne aux dents longues, fortes, droites et pointues. Cette laine cardée est appelée estame ou estaing. Concernant le peignage, l’opération nécessite quatre instruments:peignes, poteau, chèvre et potine, espèce de fourneau en terre cuite.
Les peignes formés d’une double rangée de dents de fer, les dents maîtresses et les dents chambrières, celles-ci plus courtes, plantées parallèlement sur une traverse de bois que les ouvriers appelaient « fort », « souche » ou « chappe », et qu’on pouvait tenir par un manche de bois long d’un pied, étaient assujetties au poteau, formé d’une haute pièce de bois carrée, par une petite tringle de fer appelée « chèvre ». Quand à la potine, placée aux pieds du peigneur, c’était un petit fourneau en terre cuite pétrie avec de la bourre, au couvercle percé de trous, dans lequel on entretenait un feu modéré de charbon de bois . On l’utilisait à chauffer les dents du peigne.
Le tireur d’étaim ou peigneur trempe la laine cardée dans l’huile pour la rendre plus souple et coulante. On comptait une livre d’huile pour 4 livres de laine. Les peignes une fois chauffés, on s’en servait pour briser la laine. L’ouvrier tirait la laine au peigne pour obtenir des fils de laine fins:les étaims. On estime que vingt livres de laine donnent douze livres d’étaims et qu’un tireur fait environ 1,5 livre par jour.
Ces fils de laine fins servent au tissage des étamines. L’étamine est une toile fine et légère que l’on réalise avec les meilleurs fils de laine peignée. Au XVII ème siècle, l’étamine de laine était une étoffe précieuse. Les plus belles dites « camelotées », étaient parfois mélangées avec un fil de soie, augmentant leur éclat et leur douceur. C’est un produit de luxe réservé aux gens de la noblesse, aux bourgeois et aux clergé des grandes villes. Jadis, les bourgeoises oisives avaient une prédilection pour les vêtements en étamine, légers, chauds et confortables. Les autres personnes de classe plus modeste s’habillent de serges, de telons et de droguets ; des étoffes grossières et rudes.
L’ouvrier fabriquant de la laine cardée est aussi appelé « estamier ». Quand au badestamier, c’est un bonnetier fabricant des bas en estame ou grosse laine. L’estaim ou l’estame est donc le nom donné à un fil très retors de laine peignée à chaud et filée à la quenouille.
Concernant la répartition géographique de ce métier à travers le temps, on le retrouve principalement dans les régions actuelles des pays de Loire (Maine et Loire, Sarthe et eure et loir), Nouvelle Aquitaine (la Vienne et les Deux Sèvres), en remontant un peu sur la Normandie (Orne).
Biographie d’une famille de tireur d’étaim :
Comme exemple, on va suivre une famille de tireur d’étaim en Eure et Loir.
André Brissard ou Brissac né le 6 janvier 1684, à Argon est compagnon peigneur. De son union avec Jeanne Rifort va naître André le 21 février 1728, à Margon. Il deviendra étaminier. De son union en 1749, à Nogent le Rotrou avec Julienne Garnier va naître Pierre le 7 juin 1753 au même lieu. Celui-ci sera tireur d’estaim ou estaminier. A son tour, il se marie le 4 février 1777, avec Marie Foreau. Sur les huit enfants du couple, deux seront tireurs d’étaim : Charles Félix né le 14 janvier 1780 et Louis Charles né le 24 octobre 1785.
Epilogue :
Une succession malencontreuse d’événements tant qu’économiques que politiques, sont à l’origine du déclin del’étamine. Le coup fatal fut porté par un décret révolutionnaire supprimant le port de l’habit ecclésiastique et fermant les couvents.
« Ecrire, c’est un peu tisser les lettres en un certain ordre assemblées, pour obtenir des mots, qui mis bout à bout, deviennent des textes » (Catherine Goldman)
Francis Renout
(Administrateur cgpcsm)
Sources :
Odile Halbert (modes de vie aux XVI et XVII ème siècle)
Dominique Lecointre Montagne (recherches généalogiques Perche Gouët-2012)
Guy Piau (Chronique d’un vieux carnuque-2012)
François Dornic (Du mouton du bas maine à l’étamine du Mans-1954)